Correction Bac: Supplément au voyage de Bougainville
Au 18ième siècle, le mouvement intellectuelle des lumières réunis de nombreux savants et philosophes d'Europe. Dans ce courant humaniste, Diderot encyclopédiste, intellectuel et écrivain français écrit en 1772, Supplément au voyage de Bougainville . Ce dialogue philosophique avec notre parcours '' notre monde vient d'en trouver un autre '' vient compléter le voyage autours du monde de Bougainville, navigateur er explorateur français, en ajoutant le point de vue des indiens. Ce dialogue laisse la liberté de penser au lecteur conformément au valeurs des lumières, tout en rendant le récit plus vivant.
Problématique : Comment Diderot dénonce la colonisation ? ( voir texte en photo sans prendre en compte les écris qui figurent dessus )
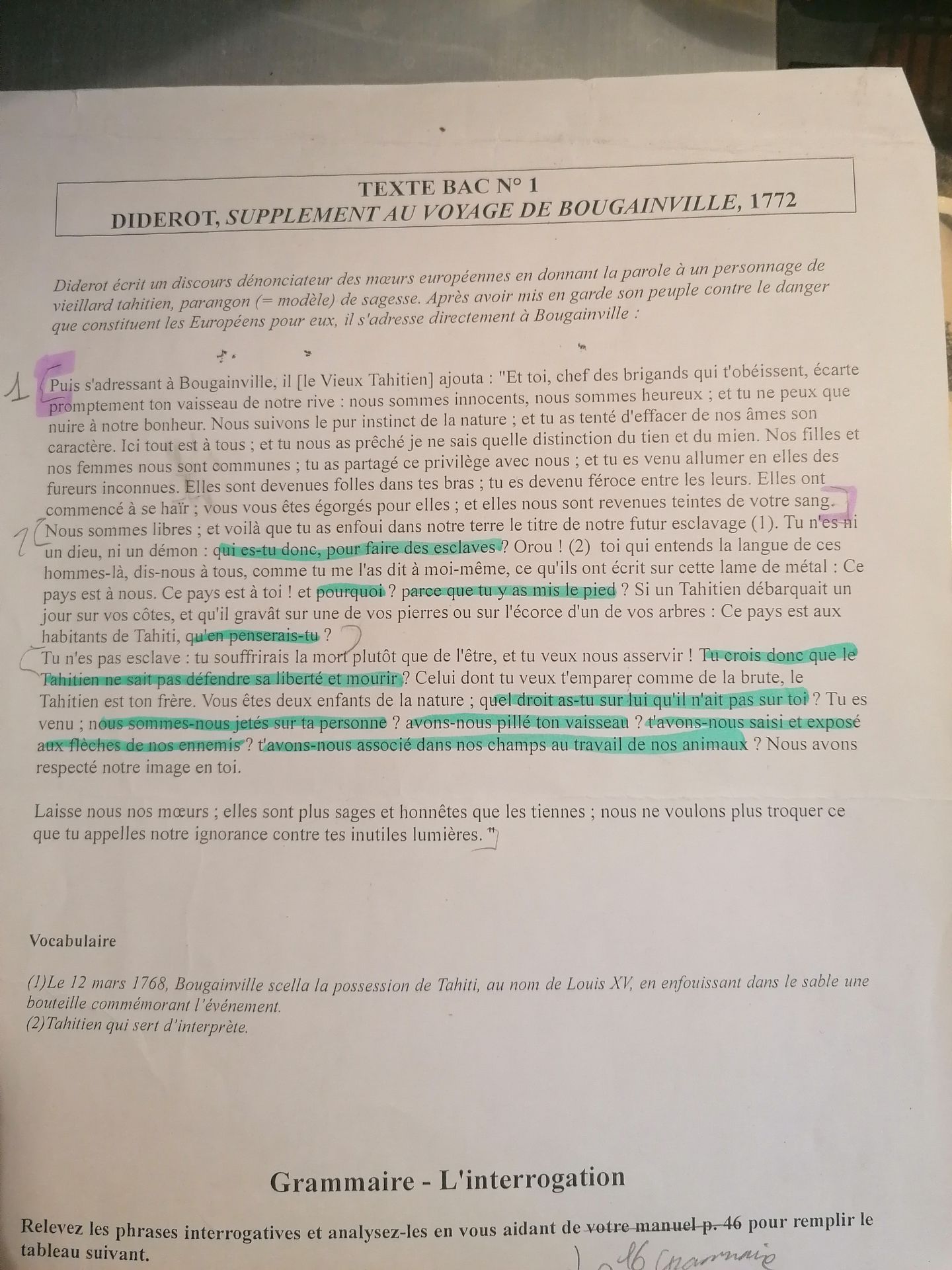
Le premier mouvement confronte la culture tahitienne considérée comme pure, à la culture européenne corruptrice.
Après s'être adressé aux tahitiens, ses amis, il s'adresse à Bougainville, chef de l'expédition européenne dans un discours très développé digne de l'art oratoire.
L'apostrophe sous forme de périphrase est agressive '' et toi, chef des brigands''
L'impératif '' écarte'' montre la détermination et l'autorité du vieillard
L'organisation du discours qui repose sur des oppositions en fait un modèle d'art oratoire.
Les antithèses vont alors parcourir tout le discours pour mettre en valeur l'opposition entre les mœurs pures des Tahitiens et la corruption amenée par les européens.
Les deux propositions indépendante s juxtaposées '' nous sommes innocents, nous sommes heureux'' s'opposent au verbe et à son et à son complément '' nuire à notre bonheur" . D'un côté, nous avons les Tahitiens qui se trouvent du côté de la nature et de son innocence ( mythe du bon sauvage) et de l'autre , les européens du côté de la société et de la culture perçue comme négatives '' nous suivons le pur instinct de la nature''
L'adj '' pur'' se définit comme '' ce qui n'a pas été altéré , ni vicié, ni pollué''. Cette idée d'une nature bonne et sans vices se retrouve chez Rousseau qui dit dans une célèbre phrases '' Lhomme est né bon, c'est la société qui le corrompt".
Ensuite, le vieillard rappelle la solidarité qui existe entre les Tahitiens par plusieurs formules pour mieux les opposer à la violence européenne
1- ''Ici, tout est à tous'', ma paronomase entre '' tout'' et ''tous'' renforce l'idée d'harmonie
2- '' nos filles set nos femmes nous sont communes'' l'adj ''communes'' renvoie encore à cette idée d'unité
3- '' nous sommes libre'' = affirmation solide. Phrase courte marquante pour une mise en évidence de la valeur fondamentale des Tahitiens.
Ces propositions mettent en valeur les qualités de la culture tahitienne s'opposent aux critiques visant les européens. Nous avons alors plusieurs antithèses présentes. les critiques sont les suivantes :
1) '' tu nous a prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien'' ( ligne 10-11). Au lieu de renforcer l'harmonie, les européens ont amené a discorde et la division; ''du tien et du mien'' mots en italiques car inconnus des Tahitien.
A noter: ironie de Diderot sur l'emploi du verbe ''prêché'': sens religieux. On prêche normalement des valeurs de paix et de fraternité. Or ici, c'est la propriété individuelle, créatrice de discorde qui est '' prêchée'' . Diderot, de manière implicite , invite à réfléchir sur le paradoxe de la colonisation : sous couvert de discours religieux, les européens agissent pour leur profit.
2) '' Elles sont devenues folles dans tes bras, tu es devenu féroce entre les leurs'' parallélisme qui met en évidence l'idée de contamination de la violence.
Passions violentes évoquées par le terme ''fureurs'' qu'on trouve dans la tragédie.
''Féroce''= connotation animale= ironie encore de Diderot : c'est au contact du sois disant civilisateur que les femmes deviennent animales. Echec de la civilisation associée à la sauvagerie: '' égorger, sang''
3) '' et voilà que tu as enfoui dans notre terre le titre de notre futur esclavage''. Violence de la métaphore. Eternité de l'esclavage ancré dans la terre
Le 2eme mouvement à partir de '' Orou !'' insiste sur l'absurdité de la colonisation
Le discours du vieillard s'adresse ensuite à Orou, Tahitien qui sert d'interprète pour dénoncer les Européens.
Cette apostrophe rend le discours vivant et vient briser la monotonie du monologue. Technique d'art oratoire encore une fois.
'' Ce pays est à nous'' : violence de l'affirmation péremptoire sans aucun fondement. '' ce pays est à toi ! et pourquoi ? parce que tu y as mis le pied ?'' question rhétorique révèle l'absurdité du raisonnement européen.
Opposition entre '' mettre le pied '' qui semble une action anodine et la prise de possession du pays.
Pour répondre à cette volonté de domination des européens, le vieillard demande à l'envahisseur de se mettre à sa place par une question de rhétorique au conditionnel présent '' si un tahitien débarquait un jour sur vos côtés et qu'il gravât [...] : ce pays est aux habitants de Tahiti, qu'en penserais-tu ?'''.
Dénonciation de la loi du plus fort comme inique '' tu es le plus fort'' , la force physique n'égale pas la force morale des Tahitiens, leur vertu.
''Tu n'est pas esclave: tu souffrirais la mort plutôt que de l'être , et tu veux nous asservir ! tu crois donc que le Tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir ?'' Opposition / absurdité . Question rhétorique = affirmation de la force des Tahitiens.
''celui dont tu veux t'emparer comme de la brute, le tahitien est ton frère. Vous êtes deux enfants de la nature'' opposition pour mieux montrer l'égalité . Les européens font fausse route en imaginant une hiérarchie parmi les hommes et en pensant pouvoir asservir leur égaux. Revendications d'une humanité indivisible.
La série de questions rhétoriques agit comme démonstration de la thèse du vieillard qui souhaite la paix '' quel droit as-tu sur lui qu'il n'ait pas sur toi ?[...]t'avons -nous associé dans nos champs au travail de nos animaux ?''
'' Nous avons respecté notre image en toi '' = affirmation forte d'un humanité indivisible. respecter l'autre c'est respecter sa propre humanité
Conclusion du discours ( tu n'es pas esclave = fin )
'' Laisse nous nos mœurs : elles sont plus sages et honnête que les tiennes; nous ne voulons plus troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières ''
Le discours s'achève sur une formule percutante ce qui montre que le vieillard maitrise l'art de la parole; c'est aussi une manière pour Diderot de montrer l'art oratoire et les solides raisonnements ne sont pas l'apanage ( bien exclusif, privilège) des européens.
L'impératif à valeur d'ordre '' laisse-nous'' met en évidence la résolution du vieillard de ne pas se laisser faire et aussi son intelligence, car il a su repérer ce qui se cachait derrière les belles apparences européennes.
Le comparatif '' plus...que'' montre que les tahitiens dépassent les européens en termes de qualités morales, notamment en sagesse et en honnêteté .
L'oxymore '' inutiles Lumières'' vient renforcer l'argumentation du vieillard et crée une antithèse avec le mot ''ignorance '' qui désignerait le peuple sauvage . Il préfère être moins instruit , mais avoir une intelligence du cœur plus élevée. Les Tahitiens possèdent l'essentiel, non la richesse et la force, mais la vertu , plus particulièrement la sagesse, l'équilibre, la bonté.
{ NDA = je n'ai pas fait de conclusion pour cette correction de bac ^^' , tout simplement car je ne la retrouve plus, si vous avez des questions, ou des demandes n'hésitez pas à demander ! }
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro