🛣 Stylistique comparée [A-]
Un manuel de linguistique !!
...
Wouha quelle ambiance ! 👏
Ça a l'air de vous passionner !
Non, pour de vrai, ce sujet est incroyablement intéressant.
Vous utilisez des mots au quotidien, comment les choisissez-vous ? Pourquoi ceux-ci ? Qu'est-ce que cela dit de votre perception et de l'analyse que vous faites du réel ?
Si vous aviez d'autres mots, une autre langue, pensez-vous que vous décririez les choses de la même manière ?

Titre : Stylistique comparée du français et de l'anglais
Auteurs : Jean-Paul Vinay, Jacques Darbelnet 🇨🇦 (linguistes)
Date : 1958, édition revue et corrigée en 1977
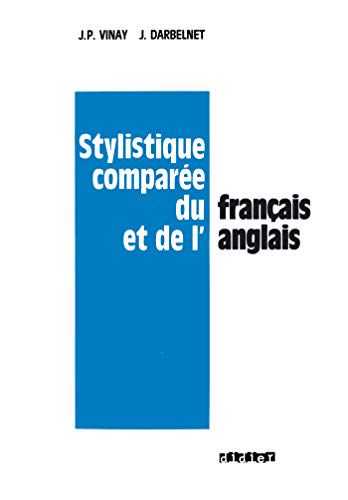
Résumé (Babelio)
Dans l'ouvrage Stylistique comparée du français et de l'anglais paru pour la première fois en 1958, Jean-Paul Vinay et Jacques Darbelnet analysent la problématique des procédés de traduction.
La théorie de J.-P. Vinay et J. Darbelnet a largement influencé les procédés de traductologie et leurs développements, de la traduction dite directe à la traduction dite oblique.
Il a été démontré que certains de ces procédés continuent à servir aujourd'hui de base pour les recherches scientifiques des traductologues. Il en est ainsi avec le cas de procédés suivants : emprunt, calque, transposition, modulation. Les recherches qui s'effectuent sont plus vastes et englobent plus de problèmes de traduction que ceux envisagés par J.-P. Vinay et J. Darbelnet.
Les autres procédés, la traduction littérale, l'équivalence et l'adaptation n'ont pas trouvé leur chemin dans la traductologie contemporaine. Soit on les rejette (traduction littérale en quelque sorte), soit on voit plus de perspectives dans les recherches (l'équivalence, l'adaptation).
Il est à constater néanmoins que d'une part, la théorie de J.-P. Vinay et J. Darbelnet fait partie de l'histoire de la traductologie, et d'autre part, elle reste toujours actuelle pour les scientifiques et les traducteurs.

Pour se comprendre soi-même, il faut se mesurer à l'altérité. En effet, chaque définition de soi par un « je suis » exclue mécaniquement un « je ne suis pas ».
Ici, en appliquant cette maxime au langage ; si on parle français, on ne peut mesurer ce que cela induit en biais, ambiguïtés, connotations involontaires, amalgames et imprécisions de la pensée... qu'en le comparant avec d'autres langues qui ne partagent pas ces défauts.
Avec ce livre, je découvre que ces réflexions constituent un pan entier de la recherche en linguistique.
Pour faire simple, la stylistique comparée est l'étude théorique des différences et similitudes entre deux langues, là où la traductologie est sa mise en application.
Ce livre est à destination des étudiants et chercheurs en linguistique, mais il est tout à fait accessible à n'importe qui ; ayant moi-même pu suivre sans être du domaine. Toutes les notions sont définies au besoin et un glossaire les récapitulent synthétiquement. Les auteurs se permettent quelques traits d'humour et anecdotes.
Cependant, certaines remarques sont obsolètes. Il est amusant de les voir s'offusquer en 1958 du néologisme ridicule « démissionner » qui remplace « poser sa démission », ou encore « tester » pour « faire subir un test ».
Notons d'ailleurs que nombre des exemples choisis parlent de la Guerre Froide !
Le plus dommageable est toute la partie évoquant l'hypothèse Sapir-Whorf, qui énonce que la langue influe sur la perception et l'analyse du réel. Il s'agit d'une théorie très intéressante et passionnante sur le plan philosophique, mais par la suite la recherche scientifique a montré expériences à l'appui que les effets de la langue étaient très limités.
Voici un petit résumé de ce que j'ai retenu des différences entre français et anglais.
• Le français décrit la fonction des objets, l'anglais leur aspect.
• Le français structure le message autour de noms, l'anglais autour de verbes.
• En français, la phrase s'organise autour d'un mot signe, en anglais d'un mot image.
• Le français est une langue liée (liaisons, morphèmes « de, -t-, s- »)
• L'anglais est plus concis que le français. (Une traduction est souvent plus longue que le texte original.)
• Le français généralise et est plus abstrait, l'anglais utilise des termes particuliers et concrets. Pour un mot français général, l'anglais n'a pas d'équivalent exact mais de nombreux termes spécifiques.
• Le français est plus concis quand il est sur le plan de l'entendement ou conceptuel, l'anglais sur le plan du réel ou sensoriel.
• L'anglais a un système de dérivation (passer d'un nom à un adjectif, verbe, etc) plus régulier que le français.
• Les termes techniques sont plus compliqués et spécifiques en français, car l'anglais peut directement utiliser un nom comme adjectif.
• Le français a le singulier et le pluriel régulier. L'anglais a en plus un pluriel collectif.
• L'anglais donne des ordres avec négation, le français évite.
• Le français décrit d'abord le résultat puis le moyen, l'anglais suit l'ordre des images.
• Le français préfère l'ordre thème-propos, l'anglais l'inverse.
• Le français est subjectiviste, il fait intervenir le sujet pensant dans la représentation des évènements. L'anglais est objectiviste.
• Le français utilise des verbes pronominaux là où l'anglais utilise la voix passive. Le français utilise l'animisme, il prête aux choses des comportements de personnes.
• Il faut aussi prendre en compte la métalinguistique : les différences d'organisation sociale, de géographie, les tabous culturels, les découpages différents de la réalité...

Note : A-
J'adore ce sujet, et les auteurs l'ont rendu tout à fait limpide et accessible.
Ma seule réserve concerne les idées invalidées depuis. À la décharge des auteurs, ils ne pouvaient pas prévoir les avancées scientifiques !
> Mes notes de lecture détaillées sont dans la partie suivante ! <
Lecture : 14-19 mars 2022
Avis : 9 avril 2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro