🟥 Rouge [A]
Il était une fois... le rouge.

Titre : Rouge. Histoire d'une couleur
Auteur : Michel Pastoureau 🇫🇷 (historien des couleurs)
Date : 2016
Couverture
Édition sobre et très belle. Le titre est en relief sur une couverture entièrement rouge, tout comme les tranches des pages.
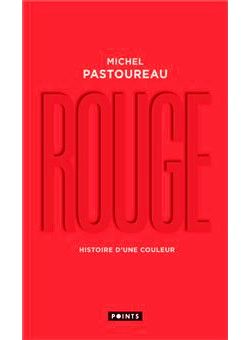
Quatrième de couverture
Le rouge est en Occident la première couleur que l'homme a maîtrisée, aussi bien en peinture qu'en teinture. C'est probablement pourquoi elle est longtemps restée la couleur « par excellence », la plus riche du point de vue matériel, social, artistique, onirique et symbolique.
Admiré des Grecs et des Romains, le rouge est dans l'Antiquité symbole de puissance, de richesse et de majesté. Au Moyen Âge, il prend une forte dimension religieuse, évoquant aussi bien le sang du Christ que les flammes de l'enfer. Mais il est aussi, dans le monde profane, la couleur de l'amour, de la gloire et de la beauté, comme celle de l'orgueil, de la violence et de la luxure. Au XVIe siècle, les morales protestantes partent en guerre contre le rouge dans lequel elles voient une couleur indécente et immorale, liée aux vanités du monde et à la « théâtralité papiste ». Dès lors, partout en Europe, dans la culture matérielle comme dans la vie quotidienne, le rouge est en recul. Ce déclin traverse toute l'époque moderne et contemporaine et va en s'accentuant au fil du temps. Toutefois, à partir de la Révolution française, le rouge prend une dimension idéologique et politique. C'est la couleur des forces progressistes ou subversives, puis des partis de gauche, rôle qu'il a conservé jusqu'à aujourd'hui.
Soutenu par une abondante iconographie, cet ouvrage est le quatrième d'une série consacrée à l'histoire sociale et culturelle des couleurs en Europe. Rouge. Histoire d'une couleur fait suite à Bleu. Histoire d'une couleur (2000), Noir. Histoire d'une couleur (2008) et à Vert. Histoire d'une couleur (2013).

Ouvrage passionnant, synthétique et très accessible, chaque situation étant remise dans son contexte historique.
À divers niveaux, sous leur apparente trivialité, les couleurs m'apparaissent mystérieuses et me semblent loin d'avoir livré tous leurs secrets.
Déjà sur le plan de nos perceptions physiques, c'est toujours déconcertant de savoir que le blanc est la somme de toutes les couleurs alors qu'il nous apparaît absolument incolore. Que dire du rose fuschia qui n'existe pas en temps que longueur d'onde ? Mais aussi, pourquoi les couleurs n'interagissent pas de la même manière en physique et en peinture ? Sans même parler du daltonisme qui nous rappelle que nous ne percevons pas forcément les couleurs de la même façon...
Ajoutons à cela des difficultés d'ordre linguistique, les couleurs sont le paroxysme de ce que les mots ne peuvent décrire que par tautologie.
Nous voyons le rouge et le rose comme deux couleurs distinctes alors qu'elles ne sont que les nuances plus ou moins vive d'une unique, car la langue française nous fait percevoir la réalité à travers son prisme. À l'inverse, nous voyons seulement du bleu là où les russes voient le bleu clair (голубо́й) et le bleu foncé (си́ний) comme étant deux couleurs distinctes.
Mais — comme si cela ne suffisait pas ! — notre perception des couleurs est influencée par les connotations qui leur sont associées.
Certaines pourraient même avoir pour origine des caractères innés à l'espèce humaine (voire animale), liée à la sélection naturelle, s'illustrant par exemple que les personnes vêtues de rouges soient perçues comme plus attrayantes.
Et ce livre répond à un certain nombre de mes interrogations avec une vision transdisciplinaire : l'histoire de la couleur relève de la physique, de la linguistique et des connotations. Ce dernier aspect est un minier d'anecdotes passionnantes sur le symbolisme chrétien, l'évolution de la chimie des teintures et les modes vestimentaires qu'elle permet, la symbolique des drapeaux, ...
Michel Pastoureau, historien des couleurs, nous raconte l'histoire de la première des couleurs : le rouge.
Ma seule et unique réserve vient du fait que ce livre est très centré sur l'Europe, et la France en particulier.
Ce n'est absolument pas un mal, et l'auteur nous prévient très honnêtement qu'il n'aborde que ce dont il est expert. Cependant, le titre ne le laissait pas présager qu'on ne se concentrerait que sur l'histoire du rouge en Europe.
Cela aurait été intéressant d'avoir plus d'éléments de comparaison avec l'histoire du rouge dans d'autres régions du monde (il y en a tout de même quelques uns).
En dehors de cette remarque vétilleuse, ce petit livre est tout simplement passionnant. Voici ci-dessous quelques anecdotes que j'ai pris en notes au fil de ma lecture.
*
Le rouge est la couleur des rituels. Il symbolise la force de vie et la mort, avec la même ambivalence que le sang.
Le rouge est la première couleur dans beaucoup de langues.
Les trois premiers mots de couleurs sont le blanc (clair), le noir (sombre), et le rouge (couleur). Viennent ensuite le jaune et/ou vert, puis le bleu, puis seulement ensuite le violet et orange, et autres nuances plus précises.
Dans certaines langues, rouge et couleur sont un même mot : en latin, « colorus » signifie rouge.
À l'Antiquité, les couleurs n'existent pas en temps que concept abstrait. Ils désignent des pigmentations. Les anciens textes confondent d'ailleurs souvent le nom du pigment et la couleur.
À Rome, la couleur rouge est à la mode pour les vêtements. Ils ont plein de pigments et savent faire les réactions chimiques qui font adhérer profondément les fibres des vêtements.
Le bleu est vue comme la couleur des barbares (celtes et germains).
Quand le bleu devient à la mode au Moyen-Âge, les teinturiers rouges essaient d'empêcher les teinturiers bleus d'acquérir leurs parts de marché. Ils demandent à ce que le diable soit représenté en bleu sur les vitraux.
Dans les tableaux, le sang de Jésus est censé être plus clair car contient moins de péchés.
Le rouge des enfers et des démons est représenté souvent avec le même pigment asiatique : sandaraque, aussi appelé « sang du dragon ». Les peintres européens pensait qu'il venait du sang visqueux et nauséabond de dragon tué par son ennemi mortel : l'éléphant ; et choisissait ce pigment pour son symbolisme.
En Europe du moyen age, le vin produit est surtout blanc. Les coupes de vin de messe sont alors opaques pour qu'on ne voit pas qu'il n'est pas rouge comme le sang du Christ.
Avant, les fidèles communiaient « les deux espèces » : pain et vin. Dans les Évangiles, il est bien écrit « Buvez-en tous ». Mais les prêtres ont considéré que le sang du Christ est trop précieux pour les gueux.
Beaucoup de cultes du sang du christ sont nés, dans la même veine du mysticisme autour du Graal.
Sainte Marie était à l'origine associée à des couleurs sombres évoquant le deuil de son fils. Puis sa couleur s'est fixée sur le bleu sombre, qui s'est éclairci petit à petit.
En 1343 à Florence, les autorités font passer le « Prammatica del vestire » pour interdire certains vêtements jugés trop luxueux. Il en résulte une archive listant la description précise de milliers de vêtements féminins.
Les blasons séparent les six couleurs héraldiques en deux groupes. Le premier : blanc (argent) et jaune (or), le second : rouge (gueules), bleu (azur), vert (sinople), noir (sable).
Une règle stricte et contraignante existe dès l'apparition des armoirie (milieu XIIème siècle) consiste à interdire de juxtaposer ou superposer deux couleurs qui appartiennent au même groupe. Cette règle tire certainement pour origine de questions de visibilité sur le champ de bataille et tournois.
Dans la vraie vie, aucune armoirie ne juxtaposent rouge et noir (à elles deux : couleurs du diable). Seuls quelques personnages littéraires particulièrement négatifs (chevalier félon, seigneur cruel et sanguinaire, prélat hérétique) le font.
En Europe au Moyen-Âge, l'opposé du blanc est le rouge (absence de couleur versus couleur), contrairement à aujourd'hui où l'opposé du blanc est le noir.
Dans toute l'Asie, noir et rouge s'opposent.
Le jeu d'échecs naît en Inde du Nord vers le VIe siècle. Au VIIIe siècle, la culture arabo-musulmane diffuse ce jeu dans tout l'espace méditerranéen. En Europe vers l'an mille, le jeu est « occidentalisé » : on change la nature et la marche des pièces, et les couleurs car elles ne sont pas opposées pour la mentalité féodale chrétienne et « les associer a quelque chose de diabolique ».
On oppose alors les camps rouge et blanc jusqu'au XVe siècle, où se met progressivement en place le jeu moderne avec les blancs et les noirs.
Les cheveux roux sont signe de la trahison. Ainsi, on trouve de de nombreux personnages de traîtres roux : Caïn et Judas (alors que rien ne le précise dans la Bible), Ganelon (le traître dans La Chanson de Roland), Mordret (traître dans les romans de la Table ronde), Renart (goupil rusé malin), Thor (dieu nordique le plus violent), Loki (dieu nordique fourbe et malfaisant).
Du XIV au XVIIème siècles, certaines personnes sont obligées de porter du rouge pour se signaler et se distinguer des « bonnes gens » : prostituées, bouchers, bourreaux, cagots, lépreux, simples d'esprit, ivrognes, condamnés et proscrits divers, non-chrétiens : juifs et musulmans.
Au contraire certaines teintes de rouges sont interdites car réservées à la noblesse. Par exemple le pourpre pour l'empire romain et le kermès au XIVème siècle.
Au XVIème siècle, la Réforme protestante interdit le rouge, couleur trop vive et trop voyante pour les idéaux protestants de sobriété. Seuls le noir, le gris et le blanc sont autorisés.
On parle alors de « chromophobie » qui se caractérise en par la destruction des vitraux des églises, le recouvrement des murs par une peinture blanche, l'application de tentures noires ou grises pour cacher les tableaux.
Cette scission entre la sobriété protestante et le faste catholique se reflète aussi dans la peinture : au XVIIe Rembrandt est protestant calviniste, Rubens est catholique. Saurez-vous les associer à leurs tableaux respectifs ?

À l'époque d'Aristote, l'ordre des couleurs est de la plus claire à la plus foncée : blanc, jaune, rouge, vert, bleu, noir.
Il y a des tentatives pour mettre en évidence les liens entre les couleurs, par exemple le diagramme de Kircher. À chaque fois, le rouge est une couleur centrale.

Anselme De Boodt s'intéresse au gris. Il s'étonne qu'on puisse l'obtenir en mélangeant de la peinture blanche et noire, ou bien en mélangeant toutes les couleurs.
François d'Aquilon theorise en 1613 les couleurs : les extrêmes (blanc, noir), moyennes (rouge, bleu, jaune) et mélangées (vert, violet, orange).
Combien de couleurs « de base » sont nécessaires pour créer toutes les autres par mélanges ?
Jusqu'ici, la réponse était 5 : blanc, noir, rouge, bleu et jaune.
En 1666, mais publié qu'en 1704, Newton découvre le spectre de la lumière. Le blanc et le noir sont alors exclues, ce ne sont plus des couleurs. Il ne reste alors plus que 3 couleurs primaires.
Ça a beaucoup perturbé les gens que le rouge, alors perçue comme couleur centrale, soit reléguée sur les bords du spectre.
Jusqu'au XIXème siècle, les robes de mariée étaient rouges.
Dans le conte du Petit Chaperon rouge, pourquoi du rouge ? Il y a plusieurs hypothèses.
Dans les campagnes, on faisait porter une pièce de vêtements rouge aux enfants pour mieux les surveiller.
La petite fille a pu mettre une belle robe pour aller voir sa grand-mère, sachant que les belles robes sont presque toujours rouges à l'époque.
Le rouge est la couleur de la Pentecôte, le jour où se passe l'histoire.
L'analyse de Bettelheim dans Psychanalyse des contes de fées est complètement anachronique.
« Certes cette couleur est depuis longtemps celle de la luxure et de la prostitution, mais pour la psychanalyse ce n'est nullement cela qui est en jeu dans le conte : il s'agit des premiers émois amoureux, et même charnels. Au Moyen-Âge, lorsque apparaissent les plus anciennes versions de cette histoire, et encore au XVIIème siècle, lorsque Charles Perrault en rédige sa propre version, les premiers élans du cœur et des sens ne sont pas associés au rouge mais au vert, couleur symbolique des amours naissantes. Si les théories psychanalytiques étaient ici fondées — ce dont je doute —, le Petit Chaperon rouge devrait être un Petit Chaperon vert. »
Le XVIème siècle est traversé par des guerres, famines, dérèglement climatique. Les vêtements sont teints en sombre : « bruns sourds, verts noirâtres, cramoisis violacés ».
Au XVIIème siècle, on passe à des couleurs gaies, claires, pastel, dans les bleus, jaunes, roses et gris, les fenêtres s'agrandissant permettent de mieux les voir.
En latin, « rosa » désigne la rose (la fleur), « roseus » désigne le rouge.
En vieux français, le rose est perçu comme une nuance du jaune. Elle gagne son propre nom vers 1380-1400 avec la découverte d'une technique pour faire une teinture rose vif, qui devient à la mode dans toute l'Europe. On appelle cette nouvelle couleur « incarnato » en italien (la couleur de la peau, ce qui donne en français « incarnat », en anglais « carnation ». Seule la langue allemande ne gagne pas de mot.
Au XIXème siècle en Angleterre, on habillait les nourissons indépendamment du genre en bleu ciel et rose dans les hautes classes, et blanc dans les basses classes. (Rien à voir avec la Sainte Marie.)
En 1930 cette tradition se généralise aux États-Unis puis en Europe grâce à l'apparition de techniques de teinture résistantes au lavage à l'eau bouillante, et là cela devient sexué.
Au XVIIIème, le rose est une nuance du rouge, donc associé à la virilité des guerriers et chasseurs. En 1970, la marque Barbie enterrine la symbolique féminine du rose.
De la mi-XVIIème au mi-XVIIIème, des courtisans prenaient des pastilles d'arsenic pour décolorer leur peau et mettre en valeur leur « sang bleu », dont les veines sont rehaussées de fards bleus. Technique abandonnée après une vague de décès.
Quand un homme ou une femme de la Cour de Versailles se retire sur ses terres, on dit qu'il ou elle « quitte le rouge », référence aux fards et rouge à lèvre.
Le rouge est la couleur de la Révolution française.
Sous l'Ancien Régime, un drapeau rouge levé lors d'une manifestation signalait que les choses risquait de bientôt déraper avec les autorités. Sur le Champ de Mars, le drapeau a été levé mais les autorités ont tiré sans sommation. Le drapeau a été taché du sang des « martyrs du champ de Mars ».
Les bonnets phrygiens (rouges) se répandent, avec tout de même quelques critiques : Robespierre dit n'aimer ni les bonnets rouges (sans-culottes) ni les talons rouges (aristocrates).
Pendant la Révolution de 1848, certains veulent le drapeau rouge comme drapeau national, « symbole de la misère du peuple et signe du rupture avec le passé ».
Deux visions s'affrontent. La République Rouge jacobine veut un ordre social nouveau pour éviter qu'il n'elle ne soit escamotée par la bourgeoisie comme en 1830. La France tricolore est plus modérée et veut des réformes.
Discours d'Alphonse de Lamartine :
« Le drapeau rouge que vous nous apportez, est un pavillon de terreur [...], qui n'a jamais fait que le tour du Champ-de-Mars, traîné dans le sang du peuple, tandis que le drapeau tricolore a fait le tour du monde, avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie [...]. C'est le drapeau de la France, c'est le drapeau de nos armées victorieuses, c'est le drapeau de nos triomphes qu'il faut relever devant l'Europe. »
En 1871, le drapeau rouge est celui de la Commune.
À partir de 1850, le drapeau rouge est le signe de ralliement des mouvements ouvriers, des syndicats et des partis les soutenant, notamment socialistes.
En 1917, la Révolution russe adopte le drapeau rouge, qui devient en 1922 le drapeau national.
Le drapeau rouge devient alors celui du communisme. En 1949, la Chine le choisit comme drapeau national.
Lors de mai 68, les drapeaux rouges communistes côtoient les drapeaux noirs anarchistes.
En 1900, le rose était la couleur du parti socialiste, par décoloration du rouge, plus modéré.
En 1981, avec la campagne de Mitterand, le rose redevient la couleur du socialisme.
Avec la guerre froide, le rouge n'est plus une couleur : le symbole du communisme écrase toutes ses autres symboles (enfance, amour, passion, beauté, plaisir, désir, pouvoir, justice...)
Dire que le rouge couleur préférée était revenir à se dire communiste...
Aujourd'hui à moindre échelle, le vert s'efface sous sa symbolique de défense de l'environnement, les énergies naturelles et le militantisme écologiste.
Les drapeaux nationaux contiennent à 77% du rouge, 58% blanc, 40% vert, 37% bleu, 29% jaune, 17% noir.
On appelle la « vexillologie » l'étude des drapeaux. (Comme l'héraldique étudie les blasons.)
La signalisation routière respecte le code héraldique. « De gueule à la fasce alaisée d'argent » « D'argent à deux écoliers passants de sable, à la bordure de gueules »
Le rouge représente le danger et l'interdiction, le bleu l'obligation, et le jaune quelque chose de temporaire.
Avec l'émergence des feux tricolores au début du XXème siècle, le vert est choisi, car complémentaire du rouge sur la roue chromatique. Le couple rouge-vert s'impose à cette époque comme nouvelle dualité pour signifier l'interdiction et la permission.
Dans les expressions quotidiennes le rouge évoque...
L'urgence et le danger : alerte rouge, téléphone rouge, zone rouge, être dans le rouge, être sur liste rouge, agiter le chiffon rouge.
La colère : voir rouge, se fâcher tout rouge, devenir rouge (comme une écrevisse, un coq...).
La sanction : stylo rouge, fer rouge.
Dans le marketing, on utilise beaucoup de rouge pour attirer l'attention, avec les labels, les promotions, etc.
Noël est représenté par le rouge de Saint Nicolas (tradition datant Moyen Âge donc bien avant Coca Cola des années 1930), le blanc de la neige et le vert du sapin
Le rouge est associé au monde du spectacle : rideaux rouges du théâtre et cinéma, tapis rouge.
Le rouge évoque toujours la force : le vin rouge passe pour être plus revigorant, la viande rouge plus fortifiante, les voitures rouges (Ferrari, Maserati) plus rapides, il y a même des légendes comme quoi les équipes rouges gagnent plus souvent en sport.
J'ajoute à titre personnel cette observation. Actuellement, je dirais que le rouge et le bleu s'opposent sur le spectre politique, plus foncé sur les bords du spectre.
Le jaune comme choix de la couleur officielle du parti d'Emmanuel Macron est intéressant : le jaune n'évoque rien en lui-même, mais il se distingue clairement des rouge et bleu traditionnels. Certains médias utilisent plutôt le orange pour le représenter (du jaune mais en plus vif, sachant que le vert était déjà pris par les écologistes ?) ou le violet (mélange du bleu de la droite et du rouge de la gauche). Ce choix de couleur pourrait être représentatif de la vision que les médias ont de la politique de Macron.

Note : A
En somme, cet ouvrage est passionnant, clair et accessible.
Cela donne envie d'approfondir ce sujet avec d'autres couleurs, d'autres thématiques et d'autres lieux !
Lu : 22-26 mars 2022
Avis : 1er avril 2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro